
« Qu’il est doux de ne rien faire, quand tout s’agite autour de vous« , J. Barbier
Mon parcours de veilleur
Ancien commerçant, j’habite un petit village d’une vingtaine d’âmes situé dans le sud du département de la Vienne, au cœur d’un paysage bocager très favorable aux conditions de vie de l’abeille mellifère à l’état sauvage. La parcelle que j’occupe s’étend sur un hectare planté pour un tiers d’un verger d’espèces anciennes de pommiers (greffés pour la plupart depuis 2006), tandis que les deux tiers restants, traversés par un petit ruisseau, sont en libre évolution depuis vingt-cinq ans.
Lorsque j’avais une dizaine d’années, mon père m’a un jour permis de prendre à mains nues un essaim d’abeilles posé sur une branche. J’ai gardé de ce premier contact un souvenir fabuleux de douceur et de chaleur. Cinquante ans après, j’ai repris contact avec ce peuple fascinant, doté de capacités de résistances largement sous-estimées.
En 2016, nos enfants nous ont offert une ruche et j’ai ainsi fait mon entrée dans le monde de l’apiculture. Très tôt, j’ai décidé de mettre en commun quelques connaissances en formant pour l’occasion le collectif Abeille (1), dont les objectifs étaient la mise en place de ruches destinées à une petite production familiale, le recensement des colonies d’abeilles mellifères vivant à l’état sauvage sur une période de dix ans (2017/2027) et la comparaison des taux de survie de colonies installées dans des ruches et de celles vivant à l’état sauvage.

Un constat alarmant
Cette première expérience d’apiculture en réseau, inspirée par un modèle reposant sur le fonctionnement naturel des abeilles mellifères, nous a incité l’année suivante à élargir le périmètre de nos actions. Au même moment, un cri de désespoir, relayé par le tapage médiatique portant sur la disparition possible de l’abeille mellifère, nous a interpellé : « Les abeilles disparaissent ! » entendait-on sur toutes les ondes… Face à l’emploi de plus en plus massif de pesticides depuis les années 1960, à l’arrivée de Varroa destructor dans les années 1980 puis à celle du frelon à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax) dans les années 2000, et considérant les interventions humaines comme l’importation massive d’abeilles exotiques, le renouvellement systématique des reines dès la première année et la banalisation de leur insémination, les traitements chimiques de synthèse dans les ruches, le nourrissement, etc., nous nous sommes demandés si ces surmortalités spectaculaires ne pouvaient pas être liées pour partie aux intrusions humaines fréquentes et inconsidérées.
Afin de tenter d’enrayer ce processus, nous avons choisi d’œuvrer à la protection et la survie de l’abeille mellifère en nous efforçant de sensibiliser notre entourage sur ce sujet et en installant à la fois une ruche de production familiale et une autre de « biodiversité » chez toutes celles et ceux qui voulaient aider la nature. Ainsi, à côté d’une ruche classique, nous donnions la possibilité à un essaim d’investir un habitat semblable à ce qu’il rechercherait spontanément, afin qu’en adoptant des conditions de vie les plus proches possibles de l’état sauvage, il améliore ses aptitudes à la vie autonome.
Cette première expérience d’apiculture en réseau, inspirée par un modèle reposant sur le fonctionnement naturel des abeilles, nous a incité l’année suivante à élargir le périmètre de nos actions.
En outre, en compagnie d’une poignée de volontaires, nous avons décidé de répertorier puis de suivre l’évolution de colonies d’abeilles mellifères vivant à l’état sauvage dans notre secteur : le sud du département de la Vienne (zone de la Basse Marche). C’est en 2020 que le projet Veilleurs d’Abeilles Sud Vienne / Basse Marche prit son vrai départ grâce à la coopération avec Vincent Albouy, mais aussi avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Lathus (CPIE), et au partage d’informations avec plusieurs pays. L’objectif était de pouvoir accumuler assez de données pour documenter sérieusement le retour à la vie sauvage de colonies d’abeilles mellifères.
La mission des Veilleurs d’abeilles : respecter le mode de vie naturel d’Apis mellifera

Comme l’écrivait l’entomologiste Guillaume Lemoine en 2022 dans la revue Abeilles en liberté : « Si nous décidons d’arrêter de vouloir tout maîtriser et tout corriger, ne devrions-nous pas tout simplement nous attendre à avoir moins d’abeilles, mais avec des colonies plus rustiques et résistantes aux nouvelles conditions écologiques ? Les abeilles mellifères seront peut-être également plus frugales dans leurs besoins et plus modestes dans leurs productions, tout en étant moins dociles…. Ce ne sera plus ”nos” abeilles mais ”des” abeilles. Il faudra probablement abandonner notre envie de vouloir tout contrôler et de les aider à tout prix pour les maintenir dans notre modèle de pensée et de production. »(2) Ainsi, loin des pratiques de l’apiculture dominante et de son interventionnisme systématique, les objectifs des Veilleurs d’Abeilles sont de recréer les conditions pour que l’abeille mellifère puisse vivre dans son milieu naturel et d’offrir des ruches d’hébergement pour les essaims vagabonds.
Notre réseau s’est constitué par le « bouche-à-oreille » et par l’intermédiaire des connaissances de chacune et chacun. En 2018, Vincent Albouy nous a rejoint et sa collaboration nous soutient tout en nous invitant à aller plus loin. Trois fois par an, nous nous réunissons pour échanger nos observations. Un protocole scientifique inspiré de celui mis en œuvre par Vincent Albouy dans son travail de suivi et de recensement nous sert de base ‒ il a cependant été simplifié pour en permettre l’accès à toutes et à tous.
L’observation et l’admiration
Partis à 5 au début de cette aventure, nous sommes aujourd’hui 35 à participer à la recherche et aux différents suivis, aidés par quelques informateurs occasionnels, et nous effectuons le suivi de 310 colonies que nous avons découvertes.Au fil du temps, en allant à la rencontre des abeilles mellifères sur le terrain,nous avons acquis la conviction qu’elles n’ont pas besoin de nous pour vivre ; l’observation et l’admiration suffisent pour satisfaire notre curiosité et répondre à nos questions sur cet être sauvage, qui ne demande qu’à le rester.
En plus du suivi global, nous effectuons, depuis 2021, un suivi hebdomadaire de 73 colonies, de mars à octobre, afin de déterminer le rythme de réoccupations des nids par ces dernières. En effet, la mortalité des essaims qui retournent à l’état sauvage peut être très importante. Beaucoup de sites que l’on peut croire occupés de manière continue par les abeilles sont en fait colonisés par une nouvelle colonie chaque année, donnant l’illusion d’une continuité. Mais si le renouvellement est suffisant, des populations peuvent prétendre à l’installation plus durable dans une zone donnée.
Au fil du temps, en allant à la rencontre des abeilles mellifères sur le terrain, nous avons acquis la conviction qu’elles n’ont pas besoin des interventions humaines pour vivre ; l’observation et l’admiration suffisent pour satisfaire notre curiosité et répondre à nos questions sur cet être sauvage, qui ne demande qu’à le rester.

Étendre la mise en commun des données
Mon désir le plus cher serait de parvenir à mettre en commun nos observations sur les colonies d’abeilles mellifères vivant à l’état sauvage sur l’ensemble du territoire français. En effet, depuis une dizaine d’années, plusieurs associations (Wild bees project, Freethebees, Honeybee watch par exemple) s’intéressent à ces abeilles « délaissées » et il est urgent de faire un état des lieux global pour préserver ces colonies et ces populations mises en danger, entre autres, par des pratiques apicoles intensives.
D’autres pays sont en train de réaliser un travail similaire ; Vincent Albouy s’est rapproché de quelques-uns d’entre eux et a déjà participé à la rédaction d’un article collectif sur ce sujet (3).
Ce travail de recensement partagé à grande échelle pourrait permettre de redonner de l’attention aux colonies — nombreuses et méconnues — qui se réinstallent à l’état sauvage, de progresser vers leur protection officielle, et servir de base à un grand renouveau salutaire de l’apiculture au service de l’abeille mellifère et de la biodiversité.
Ce travail de recensement partagé à grande échelle pourrait permettre de redonner de l’attention aux colonies — nombreuses et méconnues — qui se réinstallent à l’état sauvage, de progresser vers leur protection officielle, et servir de base à un grand renouveau salutaire de l’apiculture au service de l’abeille mellifère et de la biodiversité.

Remerciements
Merci aux 200 adhérentes et adhérents de Veilleurs d’Abeilles, qui participent, de près ou de loin, à la vie de l’association dans la joie et la bonne humeur.
- Un collectif créé au sein de l’association Brégoux Art et tradition (Vienne)
- Guillaume Lemoine, Abeilles en liberté n°15, juillet 2022
- Vincent Albouy, Dr Uwe M. Lang, Christian Zewen, Abeilles en liberté n°16, octobre 2022
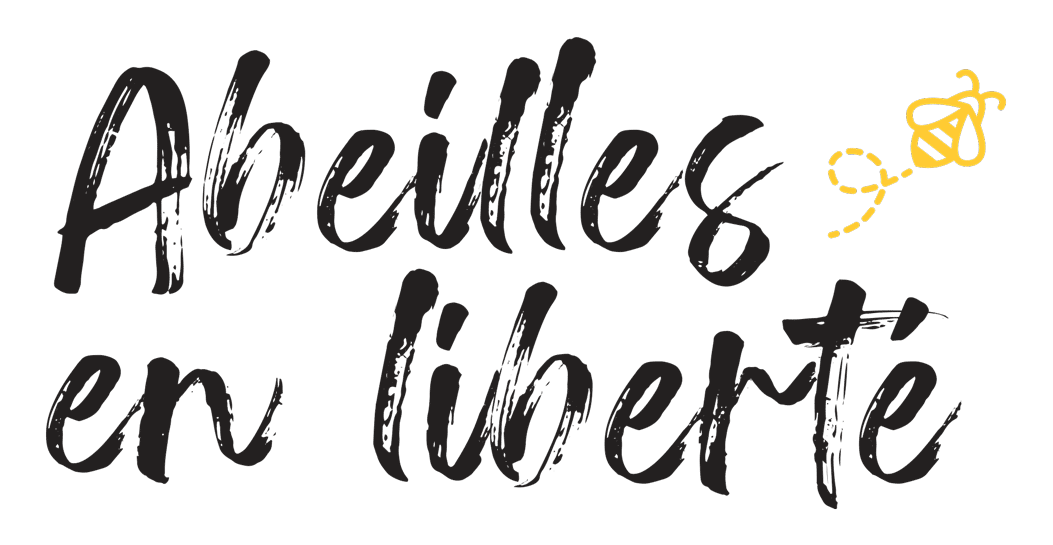

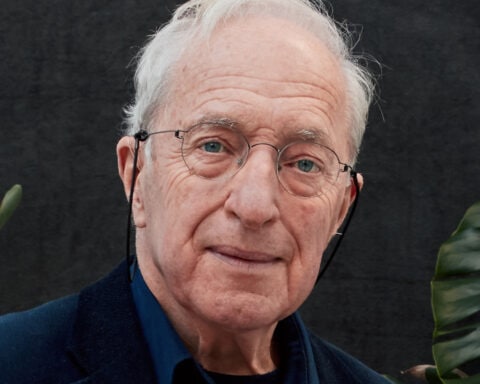




Bonjour, j’habite dans le Lot près de Cahors. Je souhaite promouvoir une apiculture naturelle plus respectueuse de la biologie de l’abeille à miel « Apis mellifera » selon la méthode Darwinienne préconisée par Thomas SEELEY auprès des apiculteurs amateurs voir professionnels.
Réensauvager des abeilles mellifères domestiques natives avec l’implantation et le suivi de ruches de biodiversité sans intervention ni récolte afin de préserver les abeilles locales.
Je voudrais également alimenter les données sur la présence de colonies sauvages avec des recensements et suivis selon le protocole proposé par l’OPIE (Office pour les Insectes et leur Environnement). Je suis à la recherche de personnes ressources pour mener à bien ce projet sur le département du Lot et vous avez précisé dans cet article le souhait de développer cette approche sur tout le territoire français. Si vous pouviez me contacter car je n’ai pas réussi à trouver vos coordonnées (téléphone ou adresse mail)
Je suis intéressé par vos activités et habite en Bretagne près de Rennes. Existe-t-il des activités de recensement des nids d’abeilles sauvages dans la région de Rennes ? Des contacts ? Et sinon quelle est la méthode pour repérer les nids, notamment en forêt ?
Quid du varroa sur des essaims dits naturels?
Merci Gilles Gagnaire pour la question.
Environ 60% des colonies vivant à l’état sauvage meurent en hiver, un taux d’essaimage important, au printemps, permet d’avoir une population relativement stable sur le long terme.
L’adaptation de l’abeille au varroa, au frelon à pattes jaunes et autres virus ne fait aucun doute; même si les apiculteurs ont des problèmes de production, l’Abeille, notamment mellifera mellifera, est bien armée pour supporter ce que « NOUS » lui faisons subir.
Le suivi hebdomadaire de 73 colonies vivant à l’état sauvage, depuis 5 ans, effectué par « Les Veilleurs d’Abeilles » ( nous sommes conscients que 5 ans n’est pas un temps long mais une photographie du moment présent) nous sert à avancer, avec prudence, ce point de vue.
Exemple :
Sur un échantillon de 49 colonies suivies :
Mars 2021 : 16 colonies vivantes.
Oct. 2021 : 38 colonies vivantes.
Malgré l’arrivée de varroa depuis les années 80, les abeilles continuent, inlassablement, à mourir…et à essaimer!!!
Très intéressant merci j’en apprends des choses sur Apis mellifera 🙂
Super article, l’approche est intéressante. Pouvez vous nous donner des détails sur le protocole utilisé pour le suivi hebdomadaire (durée d’observation, outils, fréquence des visites, seuils de mesure) ?
Olivier merci. Au niveau du suivi hebdomadaire : 5mn par site avec jumelles et longue vue, en principe chaque vendredi du 15 mars au 30 juillet; observations possibles grâce à un calendrier pour une trentaine de « Veilleurs », par groupes de deux ou trois, pour une vingtaine de sites chacun.(total 73) L’intérêt de nos observations depuis 2020 est la fréquence de réoccupation des sites et leur date, à 6 jours près.