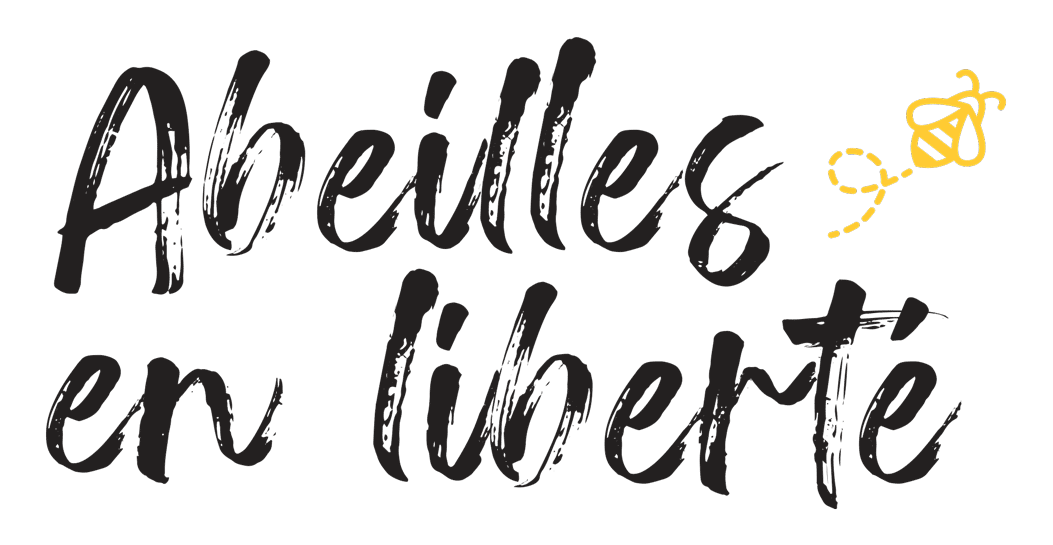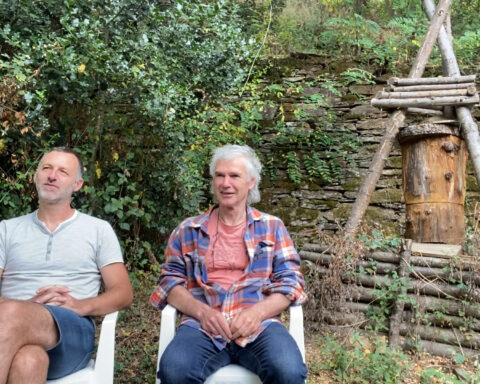Une confusion bien entretenue
Au cours du développement de l’agriculture[1], l’utilisation de ruches dans lesquelles les colonies d’abeilles consentent à demeurer s’est systématisée. Cela pourrait donner un début de crédit à la thèse de la « domestication » de l’espèce, alors qu’il ne s’agit concrètement que de les domicilier (du latin domus signifiant « maison » ou « demeure »).
En outre, les textes de loi jusqu’à aujourd’hui[2] sont eux-mêmes restés très contradictoires sur le sujet :
Une colonie d’abeilles localisée dans une ruche « appartient » au propriétaire de cette ruche, tandis qu’un essaim échappé de la même ruche, dont on ne peut prouver l’origine exacte, sauf à l’avoir suivi depuis sa constitution et tout le long de son parcours, n’appartient à personne… sinon au milieu naturel !
Les apiculteurs – et peut-être ceux qui les observent – ont certainement contribué à entretenir l’illusion d’un ersatz de pouvoir sur les abeilles qui « consentiraient » à résider dans leur ruche. Pour autant, l’abeille mellifère se montre actuellement toujours rétive à répondre aux critères de la domestication[3] d’une espèce qui résident dans :
- Des changements marqués de comportement, souvent associés à des modifications morphologiques,
- L’incapacité de l’espèce à pouvoir survivre par elle-même dans la nature,
- La maîtrise totale par l’éleveur de sa reproduction[4].

Un regain moderne du fantasme de « domestication »
L’essor de l’industrialisation a ouvert pour l’agriculture une nouvelle phase de développement, particulièrement débridée. L’apiculture a suivi le même mouvement porté par les progrès de la science et de la technique, et alimentant des prétentions folles à « maîtriser la nature ». Il est un fait qu’une fois mises en ruche[5], les innombrables abeilles constituant la colonie semblent nettement plus à la merci de leur « éleveur ».
Un regain du fantasme de la domestication de l’abeille mellifère a pris corps au début du XXe siècle, incarné notamment par un moine, le frère Adam. En 1910, lorsqu’il devient assistant du moine responsable du rucher du monastère de Buckfast, en Angleterre, il est jeune et audacieux ; mais il n’a encore que peu d’expérience en apiculture et sa culture scientifique est modeste, en particulier s’agissant de génétique[6].
Il utilise des outils modernes (la ruche Dadant), se tient au fait des découvertes scientifiques (dans le domaine de la génétique) et maîtrise des techniques modernes (notamment l’insémination instrumentale). Respectant des critères de sélection parmi lesquels la productivité figure en bonne place, il accomplit la prouesse de « créer » une nouvelle race d’abeilles mellifères par l’hybridation de différentes souches — cette quête de la race « parfaite » pour l’apiculture l’obsèdera d’ailleurs jusqu’à sa dernière heure.
Par la suite, le « rendement » en miel des colonies élevées dans son propre rucher explose. C’est ainsi que les souches d’abeilles mellifères sélectionnées par Frère Adam seront exportées en Europe, aux États-Unis et bien au-delà. Cette fabuleuse « innovation » aura contribué très largement au développement fulgurant de l’apiculture moderne productiviste.
Cependant, la durée de cette « mode » apicole aura finalement été assez courte : trois décennies d’essor fulgurant, avec une apogée dans les décennies 1970 à 1980, puis une chute en seulement trois décennies également. Certes, les trois dernières décennies ont été marquées par des bouleversements dans le contexte de l’élevage des abeilles mellifères, tels notamment l’augmentation conjointe de la pression des pesticides de synthèse, de nouveaux et redoutables parasites exotiques et l’accroissement des perturbations dues aux changements climatiques. Les souches d’abeilles mellifères issues de la sélection de Frère Adam, habituellement nommées Buckfast, se sont montrées particulièrement vulnérables face à ces fléaux.

Mais est-ce vraiment une surprise tant il semble évident aujourd’hui qu’enrayer le mécanisme naturel de sélection génétique des abeilles mellifères[7] en imposant arbitrairement une sélection sur des critères figés, pouvait comporter d’énormes risques, a fortiori lors d’une période de crise environnementale porteuse de pressions accrues.
Le procès de la tentative de domination de la nature
Des biologistes n’ont pas tardé à constater que des colonies d’abeilles mellifères vivant à l’état sauvage dans des habitats naturels s’adaptaient plutôt mieux aux aléas environnementaux que celles élevées dans les ruches des apiculteurs.
Le « procès » de l’apiculture a été progressivement dressé : trop d’interventionnisme, trop d’exigences aveugles, trop d’extractivisme… Mais les raisons plus profondes de cette « folie » ont-elles été réellement interrogées ? Si l’on tente un tel questionnement, on peut relever un premier aspect, d’ordre idéologique[8] : considérer qu’une nature immaculée fait face à de vilains humains qui lui veulent du mal est une fable qu’il convient de dépasser. En effet, nous autres, êtres humains, sommes aussi « de la nature »…
C’est pourquoi il n’y a plus lieu de nous considérer comme distincts de cette dernière, cette vision ayant largement contribué à nourrir l’approche manipulatrice et dominatrice à l’égard des êtres qui partagent notre existence terrestre et contribuent pourtant largement à notre bien-être. Et cela s’applique incontestablement aussi aux abeilles mellifères !
Un second aspect, plus trivial, est celui de la pression économique et sociale, qui ne cesse de s’accroître. Combien d’apiculteurs[9] ont ainsi cédé à la tentation d’augmenter la productivité de leur élevage d’abeilles dans l’espoir — souvent vain d’ailleurs — de réaliser au moins une petite récolte, tâchant de la sorte de « boucler les fins de mois » ?
Finalement, jouets d’un mécanisme de projection proprement humain, les apiculteurs ont attendu, sans les moindres réalisme et indulgence, un produit du travail de leurs « ouvrières », répercutant de la sorte la pression économique insensée qu’ils subissent eux-mêmes à leurs dépens.

Sortir du modèle (in-)humain de la domestication
Le fantasme de la domination des colonies d’abeilles mellifères a ainsi échoué à « concrétiser » la domestication de cette espèce, et l’obtention récente du statut d’espèce sauvage auprès de l’UICN pour les colonies européennes en libre évolution renforce encore cet échec[10]. C’était d’ailleurs couru d’avance, pour ainsi dire, Apis mellifera ne pouvant fonctionner écologiquement qu’en formant de vastes populations soumises à la sélection naturelle.
Cependant, toutes les générations qui, jusqu’à maintenant, ont projeté sur le vivant dont ils essayaient de tirer quelques ressources, leur situation sociale de travailleurs humains dominés[11], ne témoignent-elles pas, en fait, de leur propre « domestication » ? Celle exercée par l’être humain sur lui-même ?
Cette « domestication » a en effet changé les comportements humains, notamment à l’égard des autres habitants de la planète[12]. Elle a rendu l’humain moderne incapable de survivre[13] dans son environnement sans l’assistance de la technologie. Et, touche finale : elle a bel et bien fourni les moyens[14] de la maîtrise technique de la reproduction humaine.
Vue sous cet angle, l’insolente liberté des abeilles mellifères a de quoi nous faire rêver ! Le sauvage et le naturel nous interrogent avec à-propos sur notre sort « moderne », misérable à bien des égards.
Ainsi, le questionnement initial sur la possible domestication d’une espèce farouchement sauvage nous à renvoyé l’image que nous avons désespérément tenté de lui imposer : celle de la domestication. Il n’y a aucune fierté à avoir essayé de dominer une merveilleuse et indomptable espèce, aux ressources certes très prisées. Il y a encore moins, pour nous, humains, de motifs de fierté à vouloir persévérer dangereusement dans une quête de domination de nos semblables, avec toutes les conséquences délétères en cascade que cet égarement de conscience ne peut manquer d’entraîner.
Références
- [1] Qui visait une maîtrise des sources d’approvisionnement d’intérêt primordial dont les produits de la ruche faisaient manifestement partie.
- [2] Jean-Philippe Colson, L’abeille et le droit, Éditions du Puits Fleuri, 2013
- [3] La notion de « domestication », opposée à celle de « sauvage », demeure discutée, et n’a pas de contours clairement définis. Comme le suggère Jean-Denis Vigne dans son livre La domestication à l’œil nu (CNRS éditions), il n’y a pas une, mais des domestications. Ce que nous catégorisons aujourd’hui comme sauvage et domestique s’apparente en fait à un continuum.
- [4] C’est le point crucial de la domestication, sur lequel achoppe d’ailleurs l’apiculture « jusqu’au-boutiste ».
- [5] De la propre initiative de l’essaim ou avec « l’aide » de l’apiculteur.
- [6] Jacques van Alphen, Abeilles mellifères, une histoire naturelle et moins naturelle, Les Pensées Sauvages éditions, 2025, chapitre 25.
- [7] Mécanisme pourtant éprouvé depuis 6 à 8 millions d’années.
- [8] Pour ne pas dire philosophique voire spirituel.
- [9] Au nombre desquels je me compte.
- [10] https://theconversation.com/wild-honeybees-now-officially-listed-as-endangered-in-the-eu-267239
- [11] Voire d’esclaves, au sein de structures sociales inhumaines.
- [12] En comparaison des comportements des tribus, peu nombreuses, restées en dehors de la domination des civilisations dites « modernes ».
- [13] Que reste-t-il de nos libertés ? Qu’en est-il de l’expression profonde de notre être ?…
- [14] Médicaux, sociaux et juridiques.