Aller au-delà des causes externes
L’indéniable succès écologique de l’abeille mellifère occidentale (Apis mellifera) est aujourd’hui compromis, en particulier sur le continent européen ou aux États-Unis. Les causes externes de ce funeste constat sont bien documentées : pesticides de synthèse utilisés en agriculture conventionnelle, artificialisation des milieux, dérèglement climatique, pressions prédatrices du frelon à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax), etc. Sans oublier les maladies et les parasites que l’on a toutefois tendance à classer un peu vite parmi les causes extérieures, alors que leur diffusion est souvent favorisée par un ensemble de pratiques apicoles et par des conditions de production intensives plutôt récentes. En effet, le passage de l’acarien Varroa destructor de l’abeille asiatique Apis cerana sur l’abeille mellifère occidentale est clairement d’origine anthropique, tout comme sa diffusion mondiale… Mais dès qu’il s’agit de remettre ouvertement en question les pratiques prédominantes de l’apiculture et de parler des causes internes, les candidats ne se bousculent plus.
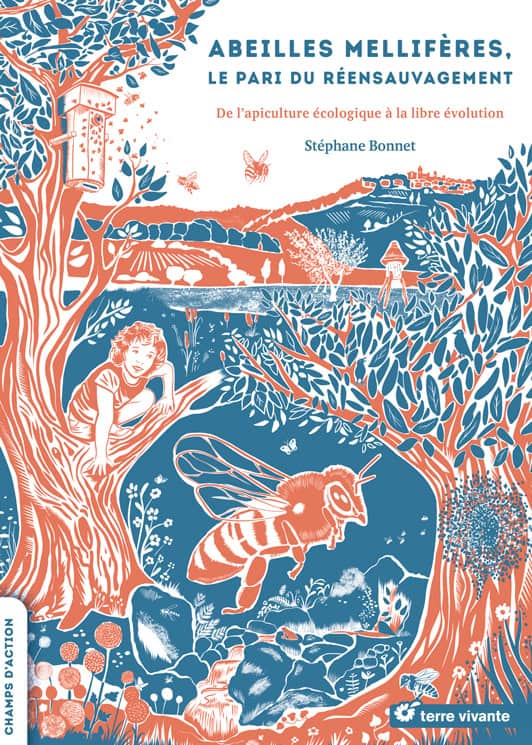
Il faut dire que l’apiculture bénéficie d’un très fort capital sympathie et que le grand public a de cette discipline une représentation très positive. La réalité est hélas assez différente, les pratiques de la plupart des professionnels étant systématiquement tournées vers l’efficacité productive et l’optimisation des prélèvements, sous la pression insoutenable du mode d’organisation sociale dominant. Si l’on ajoute au libre-échange mondialisé les bouleversements climatiques et les pollutions multiformes, l’apiculture, en tension, doit employer tous les moyens possibles pour rester dans la course… C’est ainsi que se sont généralisées des pratiques très interventionnistes (nourrissement artificiel, traitements anti-varroa, transhumances, contrôle de l’essaimage, reproduction artificielle — voire insémination, etc.) qui fragilisent encore davantage les abeilles en les rendant dépendantes du soutien de l’apiculteur, et en les privant de leurs capacités d’adaptation.
Un livre pour changer de regard
N’est-il pas vain de prétendre protéger les abeilles en les exploitant et en cherchant à les adapter à des appétits croissants en matière de miel ou de produits de la ruche ? La « domestication » des abeilles mellifères, en plus d’être un non-sens écologique, a tout d’un projet fantasmatique sans autre avenir que la surenchère interventionniste. Au contraire, le fait de nous rapprocher autant que possible de leurs conditions naturelles d’existence — en réduisant nos interventions et en laissant libre cours à leur propre organisation, en particulier sur le plan de la reproduction —, s’annonce comme un grand tournant libérateur et porteur d’espoir pour leur vitalité. C’est cette direction que prennent depuis quelques décennies les personnes souhaitant accompagner les abeilles autrement, s’appuyant notamment sur les travaux scientifiques comme ceux du biologiste Thomas Seeley aux États-Unis, qui a étudié pendant plus de 40 ans les abeilles mellifères retournées à l’état sauvage (1).

Après des décennies de recherches, Thomas Seeley a formulé, à destination des apiculteurs, des recommandations visant à imiter le mode de vie des abeilles livrées à elles-mêmes dans le milieu naturel ; cela a donné naissance à l’apiculture darwinienne. Mais ses travaux suggèrent mieux encore : la possibilité, sur des petites portions préservées d’un territoire, de créer les conditions pour que des colonies d’abeilles mellifères puissent de nouveau former des populations sauvages indépendantes de toute gestion apicole ou de toute intervention humaine… En Europe, quelques pionnières et pionniers y parviennent localement et nous montrent la voie : ce sont ces femmes et ces hommes que je suis allé rencontrer sur le terrain pour réaliser cet ouvrage, afin de mieux faire connaître leurs pratiques et transmettre leurs messages.

Les intérêts communs des abeilles libres et de l’apiculture
Ce livre n’est pas un pamphlet rédigé à l’encontre de l’apiculture. Je prends soin d’expliquer comment l’activité apicole de production peut, dans certaines conditions, contribuer à maintenir des populations d’abeilles mellifères endémiques comme l’abeille noire ouest-européenne. Cependant, en s’appuyant sur les connaissances accumulées au fil du temps par la communauté d’Abeilles en liberté, cet ouvrage se propose d’interroger les idées reçues véhiculées par une vision réductrice de l’abeille mellifère, cette dernière étant considérée comme une espèce « domestique », vivant dans une ruche et qui ne serait destinée qu’à produire du miel, ou à rendre des « services écosystémiques » telle la pollinisation des cultures. Or, les abeilles mellifères ont un statut ambivalent : comme l’explique le biologiste Jacques van Alphen (2), elles sont comme les huîtres ou les moules : des êtres sauvages que l’on exploite. Ce livre réaffirme qu’il est possible de les regarder à la manière des naturalistes et pas uniquement comme des apiculteurs, et de les protéger en se plaçant « de leur point de vue ». Il puise alors dans la philosophie du vivant comme celle de Baptiste Morizot dont il s’inspire pour penser le changement de regard sur l’abeille mellifère.

Restaurer le continuum
Pour que s’opère un changement de regard salvateur sur une pollinisatrice vénérable menacée, sortons du récit classique véhiculé par l’apiculture dominante : il y a fort à parier que les abeilles mellifères sachent mieux que nous ce qu’il convient de faire pour assurer leur survie ! Les aider aujourd’hui devrait avant tout consister à préserver leur aptitude à la vie sauvage au sein de leur environnement d’adaptation évolutive.
Nous avons oublié qu’il existait, il y a encore cinquante ans, un continuum entre les colonies d’abeilles restées sauvages et celles qui étaient domiciliées auprès des humains, et que c’est cette population, soumise à la sélection naturelle, qui rendait possible une dynamique d’adaptation de l’ensemble. Malheureusement, les colonies vivant à l’état sauvage ayant été décimées par le varroa et les pesticides, ce continuum n’a pas résisté et s’est vu remplacé par l’hégémonie de cheptels apicoles non adaptatifs. Mais il n’est pas trop tard pour faire le pari de sa renaissance car le réensauvagement est en cours. Alors que l’on considérait les abeilles mellifères à l’état sauvage comme disparues en France et dans beaucoup de pays d’Europe, de nombreux témoignages contredisent ces croyances. Des scientifiques et des associations les recensent, des gardiens et gardiennes d’abeilles les hébergent. Leur présence dans nos forêts, nos falaises, voire dans les murs de nos églises, est de bon augure pour la suite de leur histoire.

Les « fidèles » de la revue trouveront, je l’espère, dans ce petit manifeste une synthèse des thèmes chers à notre petite communauté, un ensemble d’arguments structurés et des exemples fonctionnels issus du terrain qui leur permettront de continuer à relayer l’information et à défricher de nouvelles voies pratiques.
Le travail de sensibilisation des apiculteurs prendra du temps. Cependant, l’apiculture de production doit comprendre sans tarder qu’elle a tout intérêt à protéger directement la diversité génétique(3) de l’être vivant dont elle tire profit, ou indirectement en rendant possibles des pratiques soutenables qui favorisent la bonne santé des colonies par leur conservation au sein de leur milieu adaptatif. Les alternatives existent et elles fonctionnent. Elles ont parié sur le réensauvagement et pourraient s’avérer fructueuses si nous parvenions à réunir les conditions de son extension — ce qui suppose l’avènement d’une véritable révolution agroécologique à grande échelle, permettant d’enrayer le déclin du vivant.
- Thomas D. Seeley, L’abeille à miel, La vie secrète des colonies sauvages, Biotope éditions, 2020.
- Jacques van Alphen, Abeilles mellifères, une histoire plus ou moins naturelle, Les Pensées Sauvages éditions, 2025.
- L’évolution de l’abeille mellifère Apis mellifera a produit une grande diversité génétique, sous la forme de sous-espèces différentes et adaptées à leurs milieux spécifiques. Mais comme l’explique Vincent René Douarre dans la seconde partie du livre, une colonie d’abeilles ne se réduit pas à des traits ou des gènes exprimés : elle est aussi l’incarnation de toutes les informations qui sont cachées ou à l’état latent en elle, et qui peuvent ressortir si les générations suivantes en ont besoin — ce qui est d’autant plus vrai aussi à l’échelle d’une population. Les conservatoires de l’abeille noire s’efforcent donc de conserver une génétique spécifique et le milieu qui garantit la poursuite de son évolution, mais essayant de garder “l’ensemble de ce qui se transmet, ce qui est exprimé comme ce qui est potentiel”.
Pour en savoir plus sur le livre de Stéphane, retrouvez son interview en podcast pour l’émission « Champs d’action » de Terre vivante :
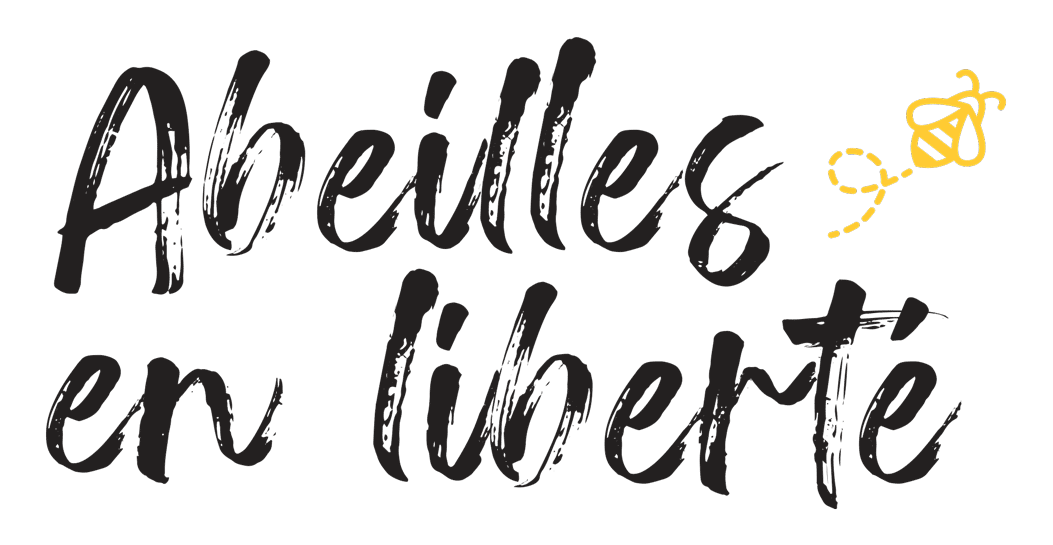






Je possède des ruches pour mon « plaisir » et par passion depuis 10 ans. Sans le savoir j’étais déjà sensible à toute votre « philosophie » et votre approche centrée avant tout sur l’abeille plus que sur l’apiculture. Les contributeurs d’abeilles en liberté m’inspirent chaque jour dans ma pratique ! Néanmoins, J’ouvre le moins possible mes ruches, je nourris le moins possible, je traite par obligation et mais plus en systématique, j’essaie donc de les laisser en autonomie au maximum. Mais je constate que mes colonies essaiment plus de 4 fois au printemps… Beaucoup de vierges naissent et semblent ne pas « s’entretuer » ce qui pousse à des essaims secondaires, tertiaires, etc… Je suis pris dans un dilemme car j’en ai marre de perdre toutes ces abeilles dans la nature, surtout car je crains qu’elles y meurent à cause de tous les maux que nous connaissons, parfois, j’ai envie de remplacer les reines mais à chaque printemps je ne parviens à m’y résoudre car tuer une reine m’accable et me dégoute par avance… Que dois-je faire malgré tout ? Car j’ai l’impression aussi de sacrifier des colonie dans la nature « inutilement ». Je constate avoir des abeilles en bonne santé, et cela aussi me fait hésiter, car je pense aussi qu’elles se « suffisent » par ces essaimages multiples mas tout de même cela m’est pénible… Et puis, je le confesse, pas une goutte de miel de surplus pour ma petite consommation, pas simple d’être privé de ce vrai plaisir ! En tout cas, merci pour vos travaux et votre engagement pour les abeilles, elles le méritent tant ! Et il me semble que c’est l’horizon à suivre, à défaut de l’atteindre pour le moment. Amitiés apicoles.
Merci pour votre message, nous sommes heureux qu’Abeilles en liberté soit une source d’inspiration !
Ce n’est pas simple de répondre à vos questions sans connaître le contexte dans lequel vous pratiquez (densité des cheptels de production dans le secteur, présence et viabilité potentielle de populations d’abeilles mellifères à l’état sauvage, préservation du milieu, etc.), sans ces données, nous devrons nous en tenir à des propos quelque peu théoriques…
Cela dit pour nous il n’y a jamais de « perte d’abeilles dans la nature » : si vos colonies ont assez de vitalité pour produire des essaims, et qu’une partie de ceux-ci s’installent dans les environs à l’état sauvage, c’est une bonne nouvelle à la fois pour les abeilles et pour le milieu. En outre, si ces colonies ont gardé des aptitudes à la vie sauvage, les années suivantes elles pourront produire des essaims susceptibles de revenir peupler certaines de vos ruches. Cela dépend de votre situation et des données évoquées plus haut.
Il est vrai que ces abeilles livrées à elles-mêmes peuvent mourir, pour plusieurs raisons dont certaines sont bien connues (pesticides, varroa, maladies, appauvrissement génétique, etc.) pouvant hélas agir en synergie — ce qui est peut-être moins connu.
Mais si vous lisez les contributions d’Abeilles en liberté, vous savez que lorsqu’elles sont installées en ruches, les colonies meurent aussi beaucoup (en moyenne 30 % de pertes par an en France) et que cette hécatombe n’est compensée que par le renouvellement artificiel permanent, qui est lui-même vecteur de diffusion de pathogènes et d’hybridation avec des génétiques exogènes… Le caractère non durable de ces pratiques d’assistance perpétuelle aux abeilles sans lesquelles tout s’effondre a été abondamment dénoncé ici. Ce réflexe de remplacement de reines s’apparente d’ailleurs à une sorte de tropisme apicole et à une « injonction à produire » faisant davantage partie du problème que de la solution !
Aider les abeilles, c’est œuvrer au maintien de conditions environnementales permettant la préservation de leur dynamique d’évolution, ce qui ne veut pas forcément dire renoncer à des récoltes occasionnelles de miel. Je vous recommande la lecture du livre de Jacques van Alphen https://www.les-pensees-sauvages.org/produit/abeilles-melliferes-une-histoire-naturelle-et-moins-naturelle/ celui-ci donne des clés de compréhension globales tout en rentrant dans de fins détails éclairants.
100% d’accord… cela dit, il y a aussi des réalités économiques derrière l’apiculture. J’ai choisi d’en faire mon activité principale. Rien que les cotisations MSA me coutent un demi fut d’acacia. Pour le consommateur, du miel reste du miel… pourtant, j’aimerais faire une apiculture plus consciente (même si c’est déjà pas si mal)… mais j’aimerais qu’elle soit valorisée un minimum. Je pose cela là !
Romain Duvivier merci pour votre commentaire, même si votre message ne donne pas beaucoup d’éléments permettant de formuler une réponse précise…
Cela semble légitime d’aspirer à vivre dignement de son activité et de souhaiter que celle-ci soit reconnue notamment par une juste rémunération. Je pense que nombre d’agriculteurs par exemple pourraient se reconnaître dans ce que vous posez là.
Toutefois, si vous êtes 100% d’accord (comme vous l’écrivez), c’est que quelque chose vous interpelle et vous pose question dans le fonctionnement actuel de l’apiculture. Les réalités économiques doivent-elles tout justifier ?
Ok mais comment traiter contre le varroa ?
La question du varroa est un point clé, mais si on ne l’aborde que sous l’angle du traitement on ne sortira pas de l’impasse actuelle. Saviez-vous que dans le sud du continent africain, les sous-espèce d’abeilles mellifères A. m. capensis et A. m. scutelatta sont devenues résistantes au varroa en 7 ans maximum ? À présent le varroa n’a pas disparu d’Afrique du Sud mais les abeilles vivent avec. Pourquoi cela ne se passe pas comme ça chez nous ?
La réponse est donnée par Jacques van Alphen dans son livre : « Abeilles mellifères, une histoire naturelle et moins naturelle » que nous avons publié le mois dernier. À force de sélections opérées par les apiculteurs sur les sous-espèces européennes d’abeilles melifères, des allèles (des variantes de gènes) ont été perdus, et notamment ceux qui sont sollicités à l’état naturel par les populations pour s’adapter aux pathogènes et aux parasites… Il est temps de faire savoir que ces pratiques ne sont pas durables et que les apiculteurs ont tout intérêt à préserver les capacités d’adaptation des abeilles.
Bonjour, je suis trop jeune en apiculture pour apporter des connaissances nouvelles.
Mais vu les difficultés qu’on a à maintenir les colonies en vie face au varroa, aux attaques de frelons à pattes jaunes et j’en passe, aujourd’hui, je ne vois pas comment une colonie sauvage à des chances de survie sans traitement ou protection.
Bonjour Stéphane,
Sans parler du fait qu’on demande toujours plus aux abeilles mellifères dans un contexte où leur milieu — souvent artificialisé — est pollué par la chimie de synthèse, et où elles sont soumises aux premières incidences « désagréables » du bouleversement climatique, il faut savoir qu’en Europe, les apiculteurs vont à l’encontre de la reproduction naturelle des abeilles depuis plusieurs décennies… On pratique en effet des sélections selon des critères de production purement humains (rendement, douceur, tenue au cadre, etc.), on a massivement importé des génétiques exotiques qui menacent les abeilles mellifères endémiques par introgression (transfert de gènes d’une espèce vers une autre) et on force les colonies à vivre dans des conditions très éloignées de ce qu’elles choisiraient spontanément à l’état naturel.
S’il est si difficile de « maintenir les colonies en vie » c’est parce que la logique sous-jacente est une impasse totale. Les abeilles mellifères sont des êtres fondamentalement sauvages qu’il est insensé de vouloir domestiquer et maintenir en vie artificiellement. Leur succès écologique tient à la possibilité qu’elles ont de se reproduire naturellement au sein de populations panmictiques installées à l’état sauvage dans leur environnement d’adaptation évolutive… une réalité biologique et écologique qui est ignorée par la plupart des apiculteurs, voire carrément refoulée.
Une colonie à l’état sauvage n’est rien : ce qui compte c’est qu’elle soit reliée à une population plus vaste. Des populations à l’état sauvage vivent partout dans le monde, y compris chez nous en Europe et elles gèrent le varroa, c’est un fait. Et il n’est pas étonnant, ce qui est étonnant c’est de persister à croire que ces sont les humains qui leur offre la meilleure protection et que, sans nous, elles vont disparaître.
Avec les frelons, le varroa et les pesticides, y’a plus de colonies sauvages ! Elles ne passent pas l’hiver..
Hugues Beau, c’est faux ! Des colonies vivant à l’état sauvage et résistantes au varroa existent aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient et même en Europe… Une colonie n’est rien ou presque : ce qui compte c’est qu’elle soit reliée à une population plus vaste, que les scientifiques appellent « panmictiques ».
Des populations à l’état sauvage vivent partout dans le monde, il y a même deux à trois fois plus de colonies sauvages que gérées en apiculture. Mettez à jour vos connaissances, lisez les livres de Jacques van Alphen, Vincent Albouy, Thomas Seeley…
Dans notre rucher du Calvados, où nous élevons des abeilles depuis plus de 12 ans, principalement avec la méthode Warré et la ruche kenyane, et où nos ruches BeeTower adaptées au changement climatique prédominent désormais, nous n’avons jamais utilisé le moindre produit chimique, ni aucune huile ou autre produit préventif vanté.
Oui, les abeilles meurent chez nous comme ailleurs, mais pour différentes raisons, et l’acarien n’est pas le seul responsable. Parfois, nous avons frôlé la catastrophe, avec une seule ruche survivante, mais au printemps, les abeilles ont essaimé et de nouvelles colonies se sont formées, tandis que d’autres sont venues d’ailleurs pour s’installer dans les ruches abandonnées.
Nos ruches sont isolées et ne sont pas disposées les unes à côté des autres, où les parasites et les maladies se propagent plus rapidement. Nous laissons les abeilles essaimer d’elles-mêmes quand elles le souhaitent et nous n’élevons pas de reines artificielles, qui sont, comme chacun sait, moins vigoureuses que les reines choisies naturellement par la colonie.Nous ne prélevons qu’un peu de miel pour notre consommation personnelle et n’ouvrons pas les ruches où le couvain est perturbé et où l’air propolisant, qui protège les abeilles, ne peut être rétabli qu’après plusieurs jours.
L’acarien Varroa est capable de s’adapter, comme c’est le cas pour d’autres êtres vivants au cours de l’évolution. Ainsi, les acariens les plus résistants survivent aux traitements chimiques et donnent naissance à une nouvelle génération de Varroa.
Les traitements constituent donc une méthode de reproduction idéale, même s’ils semblent éliminer de nombreux acariens.
Il y aurait encore une longue liste à dresser, mais nous n’avons pas la place ici pour tout noter… Cependant, avant toute chose, chacun devrait se poser deux questions lorsqu’il intervient auprès des abeilles : est-ce vraiment bénéfique pour elles et dans quelle mesure l’habitat choisi s’éloigne-t-il de l’habitat naturel dans lequel les abeilles vivent de préférence depuis des millions d’années ?
Ceux qui choisissent le métier d’apiculteur ont certainement d’autres motivations que celle de devenir riche. Mais là encore, il convient de se demander si l’on a vraiment besoin de gagner sa vie ainsi ou s’il existe des emplois mieux rémunérés, tout aussi intéressants et qui permettraient de financer son hobby…
En tant qu’apiculteur amateur, est-il vraiment nécessaire de passer son temps à vendre son miel sur les marchés le week-end ?
Avec nos meilleures salutations apicoles – rucher école Villa le Bosquet
C’est un peu facile de régler le problème en suggérant de changer de métier…je dirai même que C’EST le problème. Les populations se détournent de l’agriculture pour aspirer à d’autres professions sans contraintes du vivant … et celleux qui restent en agriculture se voient obligées produire davantage par actif pour nourrir les autres !
Apiculteur amateur, mes lectures, en particulier des publications d’Abeilles en Liberté, m’ont conduit à adopter une approche conforme aux dispositions que vous décrivez. Cela me réussit plutôt bien, puisque ne traitant pas mes ruches depuis près de 5 ans maintenant, après des pertes importantes les 2 premières années, j’en suis maintenant à un taux de perte de l’ordre de 30% qui probablement ne s’explique pas seulement par l’existence du varroa.
On parle beaucoup de génétique et de sélection naturelle. Voyant maintenant mes abeilles réagir lorsqu’un frelon asiatique se montre trop curieux, j’aimerais savoir si vous avez connaissance d’études mettant l’accent sur un processus d’apprentissage de la part des abeilles? S’il y a ce type de processus dans la résistance des abeilles au varroa, ce serait une raison de plus de faire confiance aux abeilles pour trouver elle-même le moyen de faire face à la menace.
Bonjour Claude et merci pour votre commentaire. Nous travaillons actuellement sur le sujet du frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) et sur la question de l’adaptation d’Apis mellifera à ce prédateur, mais, pour l’heure, nous n’avons pas connaissance de telles études. Claire Villemant — spécialiste réputée des hyménoptères — rapporte que l’on commence à observer des comportements de défense chez des colonies d’abeilles mellifères occidentales exploitées en Asie… Elle rapporte également qu’à Chypre, Apis mellifera cypria se défend contre le frelon oriental (Vespa orientalis) en formant une boule autour de lui et le tue par asphyxie, suggèrant que cette aptitude existe chez Apis mellifera mais qu’elle ne se développe efficacement qu’à la suite d’attaques de frelons répétées sur une période longue.
En Europe, ce type de comportement pourrait apparaître et se généraliser, mais cela prendra du temps. Toutefois, si les apiculteurs continuent de s’opposer à la sélection naturelle en sélectionnant les souches productives et douces, en introduisant des reines, ou en diabolisant l’essaimage, cela prendra plus longtemps ou empêchera en grande partie l’adaptation… C’est assurément un sujet à suivre, les populations d’Apis mellifera installées à l’état sauvage en France seront de bonnes indicatrices d’une possible évolution favorable.
Ça va prendre très longtemps, surtout avec des apiculteurs qui reprochent aux abeilles sauvages de propager parasites et maladies..
Jean-Noël Billard vous avez raison : cela prendra du temps car l’apiculture dominante est prise au piège qu’elle a elle-même contribué à créer, et elle n’est pas vraiment disposée à le reconnaître. Les arguments sont toujours les mêmes : impossible de revenir en arrière, une entreprise n’a pas le loisir de s’abstraire de ce qui est « rentable »… laissez faire les pros qui seuls détiennent les clés d’une bonne « gestion » des cheptels, contrairement aux amateurs (écolos) incompétents et à leur mauvaises pratiques qui font des nids à varroas…
C’est vrai qu’il faut faire attention lorsque l’on souhaite s’engager dans le non traitement du varroa, on peut créer des conditions qui le favorisent, Thomas Seeley a adressé des avertissements assez clairs sur ce point. Toutefois, la dégradation des conditions de vie des abeilles mellifères notamment en Europe, et leur appauvrissement génétique est avant tout dû aux pratiques des professionnels.
Les failles dans le système commencent cependant à apparaître, et le travail des pionniers et pionnières du réensauvagement, ou de l’apiculture naturelle, — débuté il y a une poignée de décennies — a maintenant des assises scientifiques beaucoup plus solides.
Il y a un grand travail de sensibilisation à mener car nous avons à faire à des pratiques solidement installées depuis des décennies, le tout dans un contexte marqué par l’utilitarisme. Mais il faudra bien que l’apiculture prenne conscience qu’elle est engagée sur une trajectoire non durable…
Nous au Burkina Faso en Afrique de l’ouest, nous avons les abeilles à l’état sauvage. On fait avec 😅.
Merci pour votre témoignage Hien Nibebelo Mathurin. Dans cette partie du monde l’abeille mellifère endémique est Apis mellifera adansonii, sauf erreur de ma part. C’est une sacrée chance pour vous d’avoir toutes ces populations à l’état sauvage, avec le maintien de leur milieu de vie, elles sont les seules garantes d’une apiculture durable !
Beaucoup d’hypothèses présument que les abeilles savent mieux que nous , que « dans la nature » cela se passe de cette façon …. mais quelles sont les études qui démontrent cela et font consensus, pas seulement 3 spécialistes… expliquez moi pourquoi mes abeilles noires bretonnes ont systématiquement des mycoses, si elles étaient si bien adaptées à leur environnement, elles n’auraient pas cette maladie qui entrave leur reproduction ! Vous partez de l’idée que les abeilles sélectionnées sont non adaptées à une survie sans inter
ventions humaines mais c’est un à priori également…
Si vous aviez lu mon livre, et plus généralement pris connaissance des articles publiés régulièrement sur cette plateforme, vous n’auriez peut-être pas ressenti le besoin d’écrire votre commentaire. Nos propos s’appuient sur de nombreuses études, la documentation à notre disposition est de plus en plus solide.
L’espèce Apis mellifera a entre 6 et 8 millions d’années d’existence, c’est trois fois plus que le genre Homo (la grande famille des humains) et vingt cinq fois plus qu’Homo sapiens. Contrairement à ce que vous dites, le succès écologique de l’abeille mellifère occidentale n’est donc pas une hypothèse mais un fait, et il est sans commune mesure avec la période extrêmement courte durant laquelle cette abeille a interagi avec l’espèce humaine.
Pour rappel, l’apiculture a 6500 ans environ, les ruches à cadres 150 ans et les pratiques apicoles modernes généralisées à peine 50 ans, en sachant en outre qu’en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, la majorité des colonies d’abeilles mellifères sont encore installées à l’état sauvage et indépendantes des interventions humaines.
Pour ce qui concerne les mycoses de vos abeilles, ne connaissant pas les caractéristiques de votre situation particulière, je me garderai bien de prétendre expliquer quoique ce soit. Les abeilles noires ont aussi fait l’objet de sélections par endroits et ce n’est pas parce qu’elles sont noires qu’elles sont protégées de tout. D’autre part, un rucher ne correspond à pas grand-chose d’un point de vue écologique si les colonies ne sont pas reliées à une population plus vaste.
Je maintiens que les sélections ont appauvri le génome des abeilles mellifères, notamment en Europe. Cela les prive des armes dont elles disposent à l’état naturel pour s’adapter aux pathogènes et aux parasites. Je vous recommande la lecture de l’article du biologiste Jacques van Alphen : https://www.abeillesenliberte.fr/pourquoi-les-abeilles-meurent-une-cause-oubliee/
et plus généralement son livre paru en version française récemment : https://www.les-pensees-sauvages.org/produit/abeilles-melliferes-une-histoire-naturelle-et-moins-naturelle/