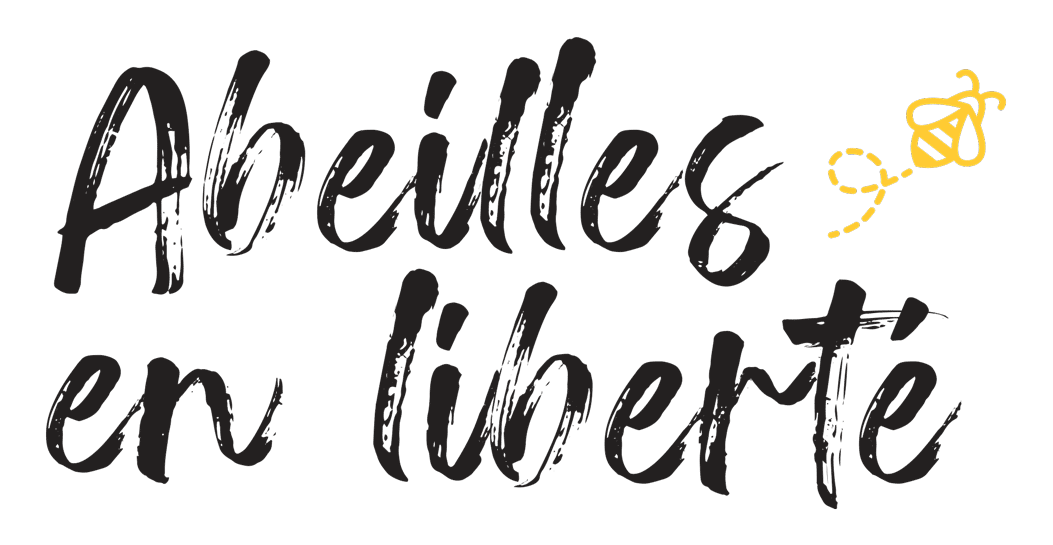Etat des lieux
L’accroissement des températures, induit par le CO2 envoyé dans l’atmosphère du fait des activités humaines, se produit à un rythme totalement inédit à notre échelle. La température moyenne est déjà montée de 1°C depuis 1880 (début de la révolution industrielle), et les scénarios du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avancent un réchauffement supplémentaire qui va de 0,5 °C (objectif de la COP 21, dite de Paris) à 4,8 °C, voire plus, d’ici 2100.
La lenteur des efforts de décarbonation de grandes économies très largement basées sur les énergies fossiles fait cependant douter du scénario de Paris et augmente la probable arrivée d’un réchauffement complémentaire plus fort, de +1,5°C à +3°C. Même si rien n’est encore définitivement écrit pour cet avenir, finalement proche, et que nous vivons une période décisive pour ce qui concerne l’action climatique, le doute n’est plus permis : un nouveau climat se met en place et les « zones de confort » thermique de nos végétaux se sont déjà déplacées de plus de 200 km vers le nord. On note aussi
des replis et des recompositions des flores, qui vont inévitablement s’accélérer car ce réchauffement moyen s’accompagne d’événements extrêmes qui, pour le coup, sortent des limites de tolérance de beaucoup de nos végétaux locaux. On parle ici de canicules à plus de 40°C, de longues sécheresses, d’invasions biologiques ou d’attaques de ravageurs facilitées par le nouveau contexte climatique (la chenille processionnaire du pin, ravageuse et allergène, progresse vers le nord de 5 km par an, et a déjà été observée à Paris, à la faveur d’hivers plus doux).

Ces « prémices du réchauffement climatique », comme les nomme le climatologue Jean Jouzel, se produisent cinq fois plus qu’il y a cinquante ans, et leurs occurrences sont corrélées – sinon liées – au réchauffement. Chez nous, ces «prémices » ont pris en avril 2021 la forme d’un épisode gélif qui est
« tombé » sur nos arbres (y compris vignes et fruitiers) alors très sensibles, à un stade de débourrement inhabituellement précoce pour cause de réchauffement puis en juin-juillet, des canicules historiques sur l’ouest canadien, et en Californie puis des sécheresses sans précédent en Russie, en Grèce, en Espagne… puis, chez nous en juillet, un fort épisode pluvieux, avec une fin d’été médiocre, favorable aux pathogènes (mildiou, oïdium). La productivité des végétaux en fut affectée, et 2021 nous a fourni peu de fruits, une piètre vendange et – faute de fleurs – la plus faible récolte de miel jamais enregistrée, à moins de 9 000 tonnes, contre 20 000 tonnes les bonnes années.
Le dernier point d’importance porte sur la ressource en eau. Les épisodes à venir de températures élevées vont augmenter l’évapotranspiration des plantes ; ceci, couplé à des précipitations plus aléatoires ou concentrées dans le temps, va éliminer les végétaux les moins résistants, installés sur sols à faible réserve en eau. Ce facteur limitant va devenir très sélectif partout sur le territoire ; on en voit les premiers dégâts y compris sur des pieds de vignes, sur sols secs, qui «brûlent » l’été, victimes d’une embolie, d’une rupture brutale de la colonne d’eau qui va de leurs racines aux pousses terminales ; une embolie en ce cas sans rémission, et qui concerne aussi des houppiers d’arbres qui se sèchent progressivement.
Un tout autre contexte nous attend, dont l’impact sur nos paysages et leurs ressources ne sera pas anodin. Nous allons implacablement vers un climat plus chaud et sec, plus aléatoire aussi avec des épisodes extrêmes, et la neutralité carbone souhaitée en 2050 ne permettra pas de retrouver le climat
du XXe siècle : il va falloir s’adapter à ce changement et accompagner flores et paysages pour en tamponner les effets.
L’impact sur la flore
Le premier constat que l’on peut faire est celui d’un impact globalement négatif sur nos flores locales. Les arbres, pourtant jugés les plus résistants, sont aussi concernés. En zone méditerranéenne, où l’eau a toujours été le facteur limitant, on observe que le chêne pubescent (l’espèce feuillue qui y est la
plus présente) souffre et montre dans ses houppiers des branches mortes annonciatrices de son déclin. En Provence, en 2019, 60 % de ces arbres sont jugés dépérissant ; le constat est le même pour le pin sylvestre, le pin d’Alep et le chêne liège. Plus au nord, et selon les conditions locales de sol, ce sont les hêtres, sapins, et chênes sessiles qui dépérissent. Celui qui semble le plus en danger est le hêtre que les forestiers ne voient plus viable au-delà d’un périmètre fortement restreint à la pointe bretonne, aux côtes de la Manche et à la Lorraine, ainsi qu’aux régions de montagne. Le déplacement des zones de confort va, bien sûr, profiter à certaines espèces méditerranéennes, mais pas à toutes, car le couperet – aléatoire – du gel restera sélectif. L’olivier remontera un peu et plus certainement la vigne et le chêne vert.
La lente recomposition naturelle de nos flores a de fait commencé : les «herbes » des espaces ouverts, celles qui sont les plus mobiles grâce à leur facile dispersion, ont débuté leurs migrations vers le nord et en altitude. La végétation arbustive des sous-bois se recompose elle aussi: on estime que près de 15 % de la flore du sous-bois des zones méditerranéennes a changé, les espèces exigeant de l’humidité disparaissant ou réduisant leur recouvrement au profit d’espèces plus résistantes à la sécheresse et à la chaleur.


Pour les arbres, cela reste moins évident tant leur vitesse de déplacement est trop faible pour une recomposition naturelle. Le chêne qui remontait, après la dernière glaciation, il y a 14 000 ans, à la vitesse de 400m par an, devrait passer à 4 km par an, au rythme actuel de réchauffement, pour rester dans son climat de confort « local ». Évidemment, il y aura parfois des pertes rapides non compensées dans certains territoires ; avec des recompositions de flores, plus ou moins lentes, sauf si nous intervenons pour les faciliter, ce que commencent à faire les forestiers.
Le second constat, sûrement le plus important pour les pollinisateurs, est l’avancement des floraisons. La mécanique à l’œuvre mérite d’être détaillée : les phases de développement des végétaux sont corrélées aux sommes des températures qu’ils subissent, au-delà d’un seuil propre à chaque plante, et défini comme son « zéro de végétation » à partir duquel elle peut se développer. Dans notre pays à forte culture viticole, la séquence de la vigne est particulièrement bien connue et éclairante. Son zéro de végétation est de 10°C et il est atteint de plus en plus tôt en saison : le débourrement a ainsi avancé de 4 jours, le début de la floraison a avancé de 14 jours, et les vendanges ont avancé en moyenne de 21 jours par rapport aux années 50.
Le raccourcissement des cycles joue pour chaque plante en fonction de son zéro de végétation : les plantes précoces (pissenlit, premiers fruitiers, etc.), à zéro plus bas, et faibles besoins en «sommes de températures» ont avancé leurs floraisons d’environ une semaine, alors que les arbres tardifs, à zéro et sommes de températures plus élevées, les ont avancées de trois à quatre semaines (tilleuls, châtaigniers, chênes, etc.). L’impact du réchauffement supplémentaire attendu (entre 1 et 3 °C) produira encore de semblables avancements proportionnels qui compacteront d’autant la période de production de nectar de l’essentiel de notre flore actuelle. Les périodes de rares floraisons estivales et automnales risquent évidemment de s’intensifier.
Notre flore dans son ensemble est bel et bien fragilisée, et certaines espèces se trouvent déjà à la limite du hors-jeu pour leurs apports écologiques, au détriment de la biodiversité qui en dépend.

L’impact sur les pollinisateurs
La baisse des populations de pollinisateurs, abeilles incluses, attestée partout, est encore accentuée par la conjonction entre ce réchauffement climatique et la dégradation de notre environnement. Nos paysages ont largement souffert de nos diverses activités depuis les années 60 : on citera la disparition des haies champêtres dont 70 % (soit 750 000 km) ont disparu de nos paysages, soit l’équivalent boisé d’un département. On mentionnera également le grignotage péri-urbain, le mitage pavillonnaire et les emprises diverses (routes, zones commerciales, etc.) en zones rurales, qui ont aussi artificialisé l’équivalent d’un département. Enfin, on soulignera la spécialisation agricole de nombre de terroirs qui a simplifié à outrance la flore agricole : ici ce sera un menu colza-tournesol, là une implacable monoculture de maïs ou de vignes, ou bien là encore un panachage fourrager sans mellifères, ray-grass et maïs…
On a ainsi façonné de vrais déserts (apicoles) sans floraisons utiles, ou bien des espaces à ressources parfois fortes mais temporaires ; et la grande majorité des zones champêtres encore arborées (bosquets, délaissés, restes de haies ) est en déshérence, faute d’avoir une quelconque utilité à nos yeux. Aussi quand les chercheurs quantifient que quasiment 30% de notre biodiversité (pollinisateurs – abeilles comprises – et autres insectes, batraciens, oiseaux, petits mammifères…) a disparu depuis les années 50, il n’y a rien d’étonnant ! La baisse des populations a suivi la baisse des ressources alimentaires qu’on a provoquée par des aménagements inconséquents et de mauvaises pratiques paysagères. L’agrochimie, les pollutions et les pesticides, sont venus en sus de ce facteur alimentaire qui ne date pas d’aujourd’hui : les chercheurs anglais pointaient dès 1930 ce problème alors que leur agriculture labourait leurs prairies naturelles, fleuries toute l’année, et y implantait ses fameux ray-grass, une graminée hautement productive sans fleurs et donc sans intérêt écologique. Le problème était alors pointé, « there is a lack of flowers ». Moins de fleurs, moins de pollinisateurs !
Le changement du climat touche à la fois les pollinisateurs et les plantes avec, globalement, deux effets :
- un avancement de la période d’activité. Les floraisons arrivent plus tôt et les insectes reprennent aussi plus précocement leur vie aérienne.
- un prolongement d’activité pour les insectes qui restent actifs plus tard en saison, voire tous les jours d’hiver doux (à plus de 10°C pour les abeilles) alors que notre végétation n’offre quasiment plus aucune floraison après celle du lierre. Certains insectes, cependant, avancent très peu leurs activités alors que d’autres les retardent; il y aurait bien des désynchronisations entre certaines fleurs et leurs pollinisateurs habituels, avec les risques que l’on imagine. L’évolution des relations entre pollinisateurs et plantes face au changement climatique est encore largement méconnu, mais le constat est sans appel: le réchauffement climatique diminue la diversité de pollinisateurs, et ce dans toute l’Europe.

Retenons que pour les abeilles, c’est double peine, car après les disettes estivales, arrivent les hivers doux. Elles vaquent dehors, alors que nos flores sont au repos. Par conséquent, elles consomment plus leurs réserves de miel que lors des hivers froids, courant le risque d’une famine hivernale. Les apiculteurs californiens voyant maintenant ce phénomène chaque hiver, ont le choix entre faire hiverner leurs ruches plus au nord, ou les loger en chambres froides jusqu’au débourrement printanier, leur créant ainsi un faux hiver !
Le défi alimentaire à venir se fait aussi plus précis : moins de fleurs c’est moins de nectar, donc moins de miel à récolter mais c’est aussi moins de pollen; et là, les conséquences sur la santé et la vie des abeilles, celles des pollinisateurs et autres insectes, sont plus lourdes. Le pollen, c’est l’entrée de l’azote, des acides aminés, donc les protéines, c’est-à-dire des éléments vitaux ! Pour les abeilles, la nécessité en est bien détaillée : il leur faut des pollens variés (trois au moins) pour s’assurer la totalité des acides aminés vitaux; il leur faut beaucoup de pollen automnal pour leur préparation à l’hivernage et s’assurer un corps gras, riche en lipo-protéines – la vitellogénine – ; il leur faut en fait du pollen en continu, pour faciliter leur résistance aux stress divers et surtout aux pesticides. Le pollen sera ainsi le facteur limitant de nombreuses chaînes alimentaires basées sur les insectes. Sa rareté et la régression de sa qualité qui vont s’aggraver avec le changement climatique font de toute évidence partie des plus grands problèmes à résoudre pour notre biodiversité.
Réagir
Nos flores sont soumises à un changement climatique rapide qui va globalement les desservir, dans des paysages déjà dégradés : disettes et malbouffe vont concerner de nombreux insectes, abeilles et pollinisateurs. Les productions en nectar et celles – essentielles – en pollen, vont faire le yoyo parce que nos plantes locales ne joueront plus aussi bien leur rôle. Ce défi alimentaire nous renvoie à la nécessaire diversité de nos flores et à la continuité des floraisons. Des solutions existent et il en sera question plus loin dans ce dossier. Planter en fait évidemment partie : il faut absolument enrichir et diversifier ; il faut adapter les flores en privilégiant les végétaux les plus résistants grâce à leur enracinement et à leurs réserves (arbres et arbustes). Enfin, il faut partout les compléter en acclimatant de nouvelles espèces adaptées au contexte à venir (du sud et des zones tempérées du monde), pour en prolonger les floraisons.
S’assurer des ressources en continu est affaire de palette végétale, mais aussi de paysages à réaménager avec des « infrastructures écologiques » (haies, bosquets, plantations mellifères, etc.), en particulier ceux, champêtres, dont nous voyons trop le désintérêt qu’ils subissent. Soigner nos flores et nos paysages, sont nos seules options pour restaurer, sinon conserver notre biodiversité face au changement climatique.
—
Article de Yves Darricau à retrouver dans le treizième numéro de la revue Abeilles en liberté.